
Ce 24 novembre, à l’initiative de la Chine (démarche assez rare pour être soulignée), Xi Jinping s’est entretenu avec son homologue américain, Donald Trump. La raison de cet appel téléphonique semble évidente si l’on a suivi l’actualité des deux dernières semaines : les déclarations de la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, sur Taïwan ont provoqué une série de réactions indignées à Pékin. Cet épisode constitue la dernière étape d’un processus de pression sur le Japon allant crescendo depuis le 8 novembre et visant à a fragiliser la nouvelle cheffe du gouvernement, héritière de Shinzo Abe, architecte du QUAD et de l’alignement Etats-Unis/Australie/Inde/Japon destiné à contenir la puissance chinoise.
Ces pressions s’inscrivent aussi dans une volonté plus large : dissuader les autres pays de considérer le détroit de Taïwan comme ce qu’il est, à savoir une zone de transit maritime international dont la stabilité serait gravement compromise par un blocus économique ou, pire encore, par une invasion de l’île. Pékin réduit systématiquement toute préoccupation internationale concernant Taïwan à une ingérence étrangère, puisque tout ce qui touche l’île relève, selon elle, de sa politique intérieure. Cette logique ne se limite pas à Taïwan : elle s’étend à 90 % de la mer de Chine méridionale, que Pékin cherche à « privatiser » pour l’usage exclusif de ses entreprises nationales, via la militarisation des récifs et l’exploitation intensive des ressources halieutiques, minérales et énergétiques.
La stratégie discursive chinoise — très proche du dispositif de propagande extérieure russe — consiste à enfermer la lecture du monde dans une rivalité sino-américaine, où tous les autres États seraient réduits au statut de simples proxys. Dans cette vision, l’Ukraine (et les pays baltes) ne seraient que des pions de l’OTAN contre la Russie ; Taïwan (et le Japon) seraient des instruments de l’impérialisme américain contre la Chine.
Cette perspective, qui alimente les discours complotistes, est pourtant profondément inadaptée : les États-Unis de Donald Trump se rangent volontiers du côté des « forts » et des « vainqueurs », bien plus que du côté du droit international. Surtout, cette vision nie toute « autonomie » aux pays concernés. Les Philippines ne défendent pas leur zone économique exclusive (ZEE) par vassalité envers Washington, mais pour protéger leurs ressources halieutiques et leur accès à la mer ; l’Ukraine ne résiste pas à la Russie en vassal de l’OTAN, mais pour empêcher la russification forcée et les déportations massives de sa population ; le Japon ne s’inquiète pas de Taïwan pour complaire aux États-Unis, mais pour protéger ses propres îlots situés à 100 km de l’île et garantir la sécurité de son commerce mondial face à un éventuel blocus chinois.
Dans ce contexte, le fait que Xi Jinping prenne l’initiative d’appeler Donald Trump pour discuter du Japon et de Taïwan — alors que Pékin l’a fait attendre des semaines avant de répondre aux demandes américaines concernant les droits de douane — révèle le caractère crucial et potentiellement dramatique de la situation du point de vue chinois. Les mots de Xi doivent donc être scrutés attentivement. Selon l’agence de presse chinoise, il aurait affirmé que le « retour » de Taïwan à la Chine était « une partie importante de l’ordre international de l’après-guerre » et ajouté : « Au vu de la situation, il est d’autant plus important pour nous de préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. »
Ces deux phrases concentrent un récit idéologique très structuré mais historiquement problématique. Parler du « retour » de Taïwan suppose d’abord que l’île aurait été séparée d’une Chine unifiée et homogène, ce qui est contradictoire avec l’argument chinois selon lequel Taïwan aurait toujours fait partie de la Chine. Ensuite, la Chine dont Taïwan a été séparée n’est ni celle à laquelle l’île devrait se « rattacher » aujourd’hui, ni celle qui représentait la Chine lors de la définition de l’ordre d’après-guerre en 1945. La Chine des Qing a perdu Taïwan en 1895 ; la République de Chine (KMT), créée en 1912 et gouvernant Taïwan depuis 1945, représentait la Chine dans les instances internationales de l’époque ; la République populaire de Chine (RPC), fondée en 1949, n’était alors qu’un régime en devenir.
Les textes de l’après-guerre n’ont d’ailleurs jamais explicitement transféré Taïwan à une entité chinoise précise. En affirmant que le retour de l’île à la RPC serait une exigence de l’ordre d’après-guerre, Xi Jinping procède donc à une relecture anachronique de l’histoire, qui vise à présenter la situation actuelle — en particulier l’existence « de facto » distincte de Taïwan et « de jure » pour 12 pays qui reconnaissent encore la République de Chine en tant que seule représentante de la Chine) — comme un facteur de déstabilisation mondiale.
Cette logique conduit à l’idée paradoxale selon laquelle le véritable obstacle à la paix mondiale ne serait ni la guerre en Ukraine, ni les collisions répétées entre navires chinois et philippins, ni les affrontements sino-indiens dans l’Himalaya, ni les conflits persistants en Birmanie, au Pakistan ou en Asie du Sud-Est, mais bien l’existence pacifique d’un territoire autonome nommé Taïwan. Une injustice historique que la Chine, en tant que dépositaire autoproclamée du « mandat céleste », serait appelée à corriger.
Mais c’est la seconde phrase de Xi qui est la plus préoccupante : « préserver ensemble la victoire de la Deuxième Guerre mondiale ». Pour Pékin, cette victoire est avant tout celle contre le Japon. Maintenir le Japon dans une position de puissance subalterne, dépourvue de véritables capacités militaires, fait partie de cette vision. Du côté russe, la victoire de 1945 sert de fondement narratif à l’idée que toute opposition à l’expansionnisme du Kremlin relèverait du nazisme. Ce cadrage commence visiblement à s’immiscer dans le discours chinois.
Déjà dans le Quotidien du Peuple du 25 août, Wang Yingjin, directeur du Centre de recherche sur les relations entre les deux rives à l’Université Renmin, affirmait que « les forces indépendantistes taïwanaises prennent des allures de plus en plus nazies ». L’accusation est absurde : dans les années 1960, le KMT était présenté comme « nazi » par la Chine de Mao ; aujourd’hui ce sont les opposants au KMT — devenu l’allié principal de Pékin à Taïwan — qui se voient affublés de cette étiquette, certains dirigeants du Parti Communiste Chinois (PCC) allant jusqu’à qualifier le DPP de « nazisme vert ».
Dans un tel contexte narratif, il n’est pas impossible que Pékin en vienne un jour à invoquer une prétendue « dénazification » de Taïwan pour justifier une tentative d’annexion, reprenant explicitement la rhétorique russe contre l’Ukraine. Une telle « poutinisation » du discours et de la société chinoise, instrumentalisée à des fins militaires, serait non seulement dangereuse pour la région, mais profondément dommageable pour la Chine elle-même.
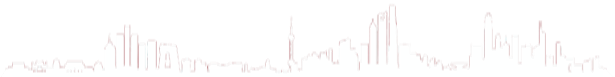

















Sommaire N° 39 (2025)