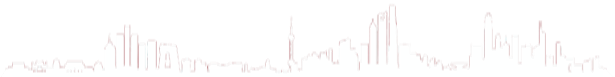Le Vent de la Chine Numéro de fin d’année (2019)
En numérologie chinoise, le chiffre « neuf » a toujours eu une signification particulière, représentant les extrêmes. Voilà pourquoi, 2019 avait débuté dans une certaine appréhension. En effet, les années se terminant en 9, ont toujours été marquées par des évènements violents, émeutes, manifestations, répressions, guerres… En 1949, le Kuomintang perdait la guerre civile et battait en retraite à Taiwan. Les communistes prenaient alors le pouvoir et Mao fondait la « Nouvelle Chine ». En 1959, le Dalaï-Lama était contraint de s’exiler en Inde. Une décennie plus tard, la Chine s’engageait dans un conflit militaire frontalier avec l’URSS pendant quelques mois. En 1979, la Chine engageait une sanglante guerre de dix-sept jours, sur la frontière sino-vietnamienne. 1989 était marqué par le Printemps de Pékin. Puis, au tournant du XXIème siècle, des manifestations anti-américaines agitaient la capitale après le bombardement de l’ambassade chinoise à Belgrade. Enfin, l’été 2009, des émeutes interethniques éclataient à Urumqi (Xinjiang) et faisaient près de 200 morts…
2019 n’échappait pas à la règle. Cette fois, c’était un projet de loi d’extradition à Hong Kong qui mit le feu aux poudres. L’ampleur de la contestation prit le leadership de court et révéla au grand jour le malaise ambiant dans la RAS. Six mois après le début de la crise, ils étaient encore 800.000 à défiler pacifiquement le 8 décembre.
2019 était aussi l’année des rebondissements, jusqu’aux dernières semaines. En réaction à l’adoption par la Chambre américaine des représentants d’une résolution visant à « sanctionner les responsables des détentions arbitraires en masse de Ouïghours », la Chine se lançait dans une vaste campagne médiatique pour promouvoir sa version des faits au Xinjiang, quelques jours avant la journée internationale des droits l’Homme (10 décembre). A cette occasion, le gouverneur du territoire autonome Shohrat Zakir, faisait une surprenante déclaration : « tous les détenus ont déjà reçu leur diplôme et trouvé un emploi. D’autres continuent à suivre des cours sur base volontaire ». Si cette affirmation est véridique, combien de détenus ont été relâchés ? Ont-ils intégré des communautés surveillées ? Quelles sont leurs conditions de travail ? Autant de questions sans réponses…
Également le 10 décembre, Pékin inculpait formellement les deux Canadiens détenus en Chine depuis pile un an, accusés d’espionnage. D’ici fin janvier 2020, M. Kovrig et M. Spavor sauront s’ils sont poursuivis. Sans hasard du calendrier, la justice canadienne se sera entretemps prononcée sur l’extradition de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, aujourd’hui en liberté conditionnelle. Dans une lettre ouverte, la fille du fondateur de Huawei déclarait avoir connu « la peur, le désespoir et le tourment » depuis son arrestation. Son sort ne réussissait toutefois pas à émouvoir le public chinois, plus préoccupé par la mésaventure d’un ex-employé de Huawei, détendu 251 jours pour avoir réclamé les indemnités qui lui étaient dues. En quelques jours, Li Hongyuan, 35 ans, devenait une icône, persécuté par son ancienne entreprise et abandonné par le système.
Sur le front de la guerre commerciale, un accord « phase 1 » était enfin annoncé le 13 décembre, marquant un cessez-le-feu, sans grand enthousiasme. Peu de détails étaient révélés sur son contenu, ce qui n’augurait d’aucune avancée majeure. Les Etats-Unis annonçaient la baisse de 15% à 7,5% de leurs tarifs douaniers sur 120 milliards de $ de produits chinois, et l’annulation d’une nouvelle salve tarifaire prévue le 15 décembre, devant frapper jouets et smartphones « made in China ». En échange, la Chine renouvelait ses promesses en matière de protection de la propriété intellectuelle et s’engageait à acheter un montant encore inconnu de produits américains, notamment agricoles (soja, porc…).
Après un an et demi de guerre ouverte, ce conflit a fait beaucoup de dégâts de part et d’autre pour très peu de bénéfices. Pour le Président Trump, cela revenait à éteindre un incendie qu’il avait lui-même allumé. Cependant, en période de campagne électorale, cette nouvelle devrait apaiser les marchés et être bien accueillie par les farmers américains. La Chine elle, n’a cédé sur aucune demande de changements structurels de son économie. Dans ces conditions, il est difficile de voir quels seraient les incitatifs pour Pékin de le faire dans une « phase 2 ». Pour l’instant, le seul constat à tirer est que cet accord ne va en aucun cas mettre un terme à la confrontation stratégique entre Chine et USA, et ce, même si Trump n’est pas réélu l’an prochain. La suite…en 2020 !

La Chine est connue pour être devenue, en moins de trente ans, l’usine du monde. Bien que ce soit toujours vrai, c’est toutefois de moins en moins le cas. Les raisons sont multiples.
D’abord il faut noter une forte augmentation des salaires, qui est une tendance bien identifiée depuis près de quinze ans, et qui se confirme chaque année, au fur et à mesure que la Chine s’enrichit : entre 2005 et 2019, le salaire horaire moyen d’un ouvrier chinois a augmenté de plus de 400% (de 8 RMB à près de 40 RMB de l’heure).
A cela s’ajoute la baisse de la population active, conséquence directe de la politique de contrôle des naissances. En 2017, celle-ci est passée en dessous de la barre du milliard de travailleurs, dont encore environ 30% dans l’industrie. Ils devraient être 830 millions en 2030.
Il y a également de nouvelles préoccupations environnementales, sacrifiées lors de la première phase d’industrialisation. Depuis, le gouvernement s’est fixé des objectifs de réduction de son impact sur l’environnement, qui pèsent sur les coûts de production. Et même si, dans le contexte actuel de croissance ralentie, la lutte contre la pollution perd en intensité, il n’y aura pas de retour en arrière.
Il faut également prendre en compte la tertiarisation de l’économie chinoise. Au cours de son développement, la part dans le PIB des secteurs primaire (7% en 2018) et secondaire (41%) s’est réduit au profit des activités tertiaires (52%). Ce nouvel équilibre montre que l’emploi se déplace en suivant le modèle des économies les plus développées pour lesquelles la part de l’industrie est largement en dessous avec 20% pour l’Allemagne ou 12% pour la France.
Enfin, les effets de la guerre économique lancée par les Etats-Unis, mettent également l’industrie chinoise sous pression. L’augmentation des droits de douanes qui en découlent sont une raison de plus pour les groupes étrangers de relocaliser leurs usines dans les pays aux coûts du travail moins élevés. C’est le cas du coréen Samsung, qui vient de fermer sa dernière usine dans le pays, à Huizhou, après 27 ans d’activité, pour rouvrir en Inde et au Vietnam. Avec son départ, elle signait aussi la mort de 100 de ses fournisseurs dans le Guangdong et de milliers d’emplois. Une tendance qui cohabite avec la tentation des pays d’Europe et d’Amérique du Nord de rapatrier ce qui peut l’être sur leur marché domestique, en faisant le pari de l’usine du futur. Cette stratégie n’est pourtant pas toujours gagnante, comme le montre l’échec récent d’Adidas, contraint de fermer ses deux « Speedfactories » implantées en Allemagne et aux Etats-Unis, parce qu’elles ne tenaient pas leurs promesses en termes de retour sur investissement et de flexibilité – avec à la clé un retour de la production en Asie !
Les planificateurs chinois n’ont pas attendu les effets de la récente crise pour lancer leur offensive. Ils se sont d’abord inspirés du plan « Industry 4.0 » allemand, qui se trouve, à son échelle, dans la même situation, voulant faire basculer son industrie dans le monde numérique.
La différence est que la Chine part avec du retard : les entreprises chinoises sont en effet peu automatisées comptant environ 50 robots pour 10 000 travailleurs, contre plus de 500 en Corée du Sud ou 300 en Allemagne. Il y a même urgence pour éviter que la Chine ne se trouve coincée entre la double compétition des pays à plus bas salaires et ceux aux moyens de production plus avancés.
C’est tout l’objectif du plan « Made in China 2025 » lancé en 2015. Il vise à restructurer en profondeur le parc de production national, en mettant la priorité sur dix secteurs comme le transport aérien, terrestre et maritime, l’énergie, l’agriculture ou la santé. Il ambitionne aussi qu’une dizaine de firmes chinoises deviennent des leaders mondiaux en ces domaines clés d’ici 2025, et que la Chine atteigne le rang de superpuissance technologique globale en 2049.
BOE Technology, géant chinois fondé en 1993 devenu en quelques années seulement le leader mondial des écrans, est l’un des exemples de réussite du plan décennal. Parmi ses 12 usines chinoises, celle de Pékin est un véritable laboratoire des nouvelles technologies manufacturières : une usine presque sans ouvrier, véritable concentré de capteurs et de robots, avec au cœur une intelligence artificielle capable d’identifier les types de malfaçons au cours du processus de production. Cela représente une économie de 50% du coût du travail. La technologie en place permet à cette usine d’être 300 fois plus rapide qu’une usine « classique ». Deux autres usines de ce type, à Chongqing et Suzhou, seront opérationnelles d’ici 2023.
Même les leaders européens et nord-américains intègrent cette évolution pour leurs usines chinoises, comme Ericsson, Honeywell, Tesla ou Schneider Electric. Ce dernier, leader de la gestion d’énergie et des automatismes, investit dans ses usines du futur sur tous les continents, dont deux en Chine. La toute dernière, ouverte cette année près de Pékin, est une véritable vitrine pour le groupe qui en attend un retour sur investissement très rapide en deux ou trois ans, et des taux de rendement en augmentation de 15 à 20%.
C’est que l’enjeu est vital. L’usine dopée à l’IA et à la robotisation, fait partie d’une chaîne de valeur dans laquelle tous les maillons doivent communiquer en temps réel. C’est notamment sur ce créneau de l’« informatique industriel» que Dassault Systèmes cherche à se spécialiser auprès de ses clients chinois. Pour ce géant français, il s’agit de digitaliser les usines pour mieux maitriser le flux des données entre toutes les étapes, de la R&D à la production, en passant par la logistique, les fonctions de gestion et la relation clients. Grâce à sa plateforme numérique, Dassault propose une solution permettant le contrôle et le pilotage des usines de demain pour en garantir la flexibilité, l’accroissement des performances et l’économie d’énergie.
Le gouvernement chinois, qui s’est fixé l’objectif de doter son industrie d’un nouvel avantage compétitif à l’horizon 2049, est donc en train d’opérer un tournant décisif pour l’avenir économique du pays. Ce sont quelques 100 millions de travailleurs, employés au cœur du système industriel chinois, qui pourraient être menacés, selon le Bureau National des Statistiques. A l’heure où les usines deviennent digitales, la réussite sera donc en partie conditionnée par la bonne reconversion d’une partie des travailleurs, au risque de voir remise en cause la stabilité sociale du pays.
Conçu dans les années 90 en tandem franco-allemand, le premier EPR au monde, réacteur nucléaire de troisième génération, prenait vie en décembre 2018 à Taishan, 150 km au sud de Canton. Neuf mois plus tard, le deuxième EPR était inauguré en septembre dernier. Une réalisation qui fait la fierté des électriciens chinois CGN (51% de la JV), de Guangdong Energy Group (19%), mais aussi d’EDF (30%) et de toute la filière nucléaire française.
En une démonstration de force, pour la deuxième unité de Taishan, la phase de test avant mise en service a été d’une durée comparable à celle des réacteurs standards CPR-1000 chinois. Ensemble, les deux réacteurs possèdent une capacité de 3500 mégawatts et sont dimensionnés pour produire jusqu’à 24TWh, suffisamment pour alimenter 5 millions d’habitants de la province du Guangdong. Cela représente 21 millions de tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère chaque année, un avantage de poids pour la Chine, qui cherche à tout prix à décarboner son électricité. Tout au long du cycle, depuis l’installation au démantèlement, l’EPR ne rejette que 4 grammes de CO2 par KWh produit, et 0 gramme durant le cycle de production d’électricité, comme d’ailleurs toutes les centrales nucléaires du parc français. A l’inverse des réacteurs classiques, l’EPR est plus respectueux de l’environnement et utilise moins de combustible qu’une centrale nucléaire classique, soit autant de déchets radioactifs en moins. Il est aussi présenté comme la « Rolls » de la sureté, capable de résister au pire des scénarios catastrophes : super-typhon, crash d’un avion sur sa coque … Si le cœur entre en fusion, un récupérateur de corium est prévu sous la cuve du réacteur. En cas de coupure d’électricité, six moteurs diesel sont prêts pour rendre le relais. L’EPR intègre aussi dans sa conception les leçons tirées de l’accident Fukushima en 2011. Et c’est le seul réacteur de troisième génération qui répond aux exigences strictes des autorités de sureté nucléaire de quatre pays (France, Finlande, Chine, Royaume-Uni).
 Alors que le chantier avait débuté plus tard à Taishan (2009) que celui de Olkiluoto (2005) dans le sud de la Finlande et de Flamanville (2007) dans la Manche, comment expliquer ce succès chinois ?
Alors que le chantier avait débuté plus tard à Taishan (2009) que celui de Olkiluoto (2005) dans le sud de la Finlande et de Flamanville (2007) dans la Manche, comment expliquer ce succès chinois ?
D’abord, si la tête de série à Flamanville a essuyé les plâtres, le retour d’expérience hexagonal a permis en Chine d’adopter tout de suite certaines bonnes méthodes. Par exemple, les fondations du bâtiment réacteur ont été bétonnées en une seule fois, contre deux couches successives à Flamanville-3.
A Taishan, 84% des équipements de haute technologie dans la partie nucléaire ont été fabriquée par des entreprises françaises ou européennes. Au total, avec la participation de près de 40 firmes tricolores, le chiffre d’affaires pour la filière nucléaire française à Taishan est estimé à 2,4 milliards d’euros pour les deux tranches. Le coût de construction total serait lui de 12,35 milliards d’euros selon le rapport Folz. A noter que le taux de localisation des équipements a été plus important pour le deuxième EPR : les générateurs de vapeur, le pressuriseur et la cuve ont été fabriquées en Chine.
Le chantier a aussi bénéficié de la politique volontariste du gouvernement chinois dans le nucléaire grâce à un développement ininterrompu de la filière pendant 30 ans. Aujourd’hui, avec 48 réacteurs opérationnels et 9 autres en cours de construction, le nucléaire chinois a gagné en compétences. Il peut ainsi disposer de façon massive et flexible, d’une main d’œuvre qualifiée et expérimentée (soudeurs, monteurs, essayeurs…). A l’horizon 2030, la puissance cumulée du parc nucléaire chinoise doit atteindre 137 GW, puis 200 GW cinq ans plus tard.
Ensuite, la construction simultanée d’une paire de tranches sur un site neuf à Taishan, a été un véritable atout. La mise en service du premier réacteur a permis d’optimiser le calendrier pour le second : alors que le démarrage de Taishan-1 avait nécessité deux ans d’essais, le temps fut divisé par deux pour Taishan-2.
Surtout, c’est le fruit de deux partenaires qui se connaissent et travaillent main dans la main depuis plus de 35 ans : EDF et CGN. Ces deux groupes partagent beaucoup plus que des chantiers ensemble, l’organisation de la CGN ayant été calquée sur le modèle français à sa création. EDF et CGN ont construit un partenariat dans plusieurs domaines, depuis l’ingénierie jusqu’à l’exploitation dès le chantier de Daya Bay dans les années 80. Ce passé a créé des liens forts : récemment, les dirigeants de CGN retrouvaient avec émotion leurs formateurs français de trente ans plus tôt, et leur faisaient découvrir le site de Taishan… A ce jour, 1300 salariés de Framatome et 200 ingénieurs d’EDF sont passés par Taishan. Et les deux partenaires comptent bien continuer d’écrire l’histoire ensemble, et pourquoi pas en répliquant leur formule gagnante à Hinkley Point C dans le sud-ouest de l’Angleterre ?
A Huludao, dans la province du Liaoning, Gao Xiaodong n’avait pas eu la vie facile. A 20 ans, fuyant la misère, il était parti vers la capitale dans l’espoir d’y trouver un gagne-pain. Là-bas, il avait pris tous les petits jobs qui s’offraient à lui, et fut tour à tour assistant coiffeur, garçon de salle ou livreur. En 2002, alors vendeur en porte-à-porte, il avait assisté à une scène qu’il n’oublierait pas de sitôt : le client qu’il venait de quitter quelques minutes plus tôt venait de sortir dans la rue, suivi de son pékinois dont l’arrière-train paralysé reposait sur un genre de planche à roulettes. Loin d’être gêné par le dispositif, le chien avançait fièrement sur ses deux pattes avant, haletant de bien-être. La scène avait ému Xiaodong qui, depuis l’enfance, adorait les animaux.
En 2004, il décida finalement de retourner à Huludao : ses parents venaient de lui trouver une épouse, Fu Lijuan, et la fête de mariage devait s’y dérouler prochainement. Depuis son départ, ce pauvre bourg de province, avec ses 2,7 millions d’âmes, s’était mué en un puissant poumon industriel. Après son mariage, Xiaodong trouva un travail dans une fonderie étatique qui lui assurait au moins un fiable salaire mensuel – une chance que bien des amis lui enviaient. Mais lui-même maugréait, s’ennuyant ferme dans les bureaux de l’usine. A la maison, il passait son temps libre à rechercher des opportunités pour se mettre à son compte, et pouvoir s’adonner à ce qui le passionnait vraiment : les animaux de compagnie.
Un jour, alors qu’il surfait sur internet, il tomba sur une annonce d’une firme coréenne qui proposait des fauteuils roulants pour animaux mutilés. Et là, en un éclair, lui était revenue la scène du bâtard joyeux sur sa planche à roulettes. Son sang ne fit qu’un tour : le soir-même, avec son épouse, ils bricolèrent leur premier prototype, à partir d’un cageot, de fil de fer, de roulettes et d’une paire de patins éculés. Dès le lendemain à l’aube, ils attirèrent un chien boiteux qui venait quotidiennement se repaître de leurs restes. Confiant, l’animal se laissa harnacher de l’appareil spécialement dessiné pour son infirmité. L’engin branlant n’était pas fait pour inspirer la confiance – et pourtant, le médor s’en fut guilleret, suivi par le couple émerveillé de l’immédiat succès. Dans la foulée du chien, Gao décida illico d’abandonner sa place en usine pour se consacrer à cette voie nouvelle !
Apprenant sa décision, ses parents s’irritèrent grandement, pensant que le fiston était tombé sur la tête. De fait, les débuts en 2008 s’avérèrent difficiles – les premiers modèles ne se vendirent qu’au rythme d’une demi-douzaine par mois, à deux ou trois cents yuans pièce. Il n’y avait là pas de quoi faire bouillir la marmite.
Et pourtant, les années suivantes virent changer la fortune de Xiaodong. De bouche à oreille, sa notoriété s’était étalée comme des ronds dans l’eau à travers la province. Des gens, désespérés par la vieillesse difficile de leurs chiens ou chats, étaient prêts à payer rubis sur l’ongle pour améliorer leur quotidien. Tel fut le cas de Mme Wei Lijun, quinquagénaire de Shanghai qui ne dormait plus, se faisant constamment du mouron pour Fufu, son fidèle compagnon canin depuis 19 ans. A son AVC, il avait survécu, mais restait depuis inerte dans son panier, tentant parfois de se trainer sur ses pattes avant indemnes. A la solution préconisée par tous, la piqure, Mme Wei refusait de se résoudre. Et voilà que sur internet elle découvrait qu’elle pouvait commander un kit de déplacement canin, la solution miracle, pour à peine 630 yuans. Après avoir déballé fiévreusement l’appareil contenu dans le colis, elle avait découvert un justaucorps élégamment cousu, qui semblait taillé sur mesure pour son petit chéri. Ajustant les sangles à la taille du canidé, elle le vit soudain se lever, ce qu’il n’avait plus pu faire depuis trois mois, s’ébrouer, et puis se diriger vers la porte d’entrée, réclamant impérieusement sa promenade !
Depuis, Gao avait vu son affaire grandir, et son chiffre d’affaire exploser. Dans son atelier mécanisé, avec ses huit employés, il sort désormais 4 000 engins roulants pour animaux par an, dont 1 000 destinés à l’exportation. 90% des harnais ou chariots sont destinés à des chiens, du chihuahua au labrador, et 9% à des chats. Mais son offre répond également à des besoins spéciaux pour tout ce que la terre compte d’espèces domestiques à quatre pattes : lapins, tortues, cochons, voire chèvres ou chevaux.
Le secret de sa réussite est lié à un tumultueux changement de sensibilité des Chinois vis-à-vis des animaux de compagnie. A mesure qu’ils vieillissent, ou qu’ils s’éloignent de leur famille pour chercher de meilleures opportunités, ils réalisent leur solitude, et la combattent en se dotant d’un compagnon à poils dont la fidélité aveugle leur est éternellement garantie. Et le marché progresse à une vitesse folle : les foyers chinois abritant chien ou chat sont désormais 100 millions, en hausse de 44% en 5 ans. Le commerce de l’animal de compagnie en Chine atteignait l’an dernier 24 milliards d’euros, et le marché de la « mobilité animale » a progressé de 40% en 2018.
Ce nouveau contrat entre l’homme et la bête, fait donc la fortune de Gao Xiaodong, qui dispose du quasi-monopole des « chaises roulantes » pour compagnon à quatre pattes en Chine. Ce succès, Xiaodong le mérite amplement (有劳得奖 yǒu láodé jiǎng) mais ce dont il est le plus fier est de pouvoir rendre, par son travail, un peu plus belle la vie de milliers d’animaux chaque année.