Le Vent de la Chine Numéro 14 (2025)

Après « Je t’aime »/« Moi, non plus », Washington et la Chine nous livrent un nouveau duo de « Je ne t’aime pas »/« Moi aussi ». Les deux géants économiques, militaires et technologiques continuent de s’entendre à ne pas s’entendre et de réciproquement affirmer puis nier se parler ou ne pas se parler. Ce qui n’aide en rien à clarifier une situation déjà obscure.
Entre un « pervers narcissique » comme le président américain qui pense toujours avoir gagné (selon la définition de Paul-Claude Racamier : « le pervers narcissique se définit comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, aux dépens d’autrui ») et un « paranoïaque compulsif » comme l’actuel dirigeant chinois qui fait tout pour ne jamais pouvoir perdre (la paranoïa est définie comme « une tendance omniprésente à la méfiance injustifiée, où la suspicion des autres mène à interpréter leurs motifs comme malveillants »), la partie est complexe et la raison économique n’est pas forcément le motif principal.
 Ce dessin duTelegraph résume bien la situation : tout l’art du deal consiste semble-t-il à ne pas donner l’impression de céder le premier – tandis que le reste du monde panique et veut savoir à quelle sauce il va être mangé.
Ce dessin duTelegraph résume bien la situation : tout l’art du deal consiste semble-t-il à ne pas donner l’impression de céder le premier – tandis que le reste du monde panique et veut savoir à quelle sauce il va être mangé.
Reprenons donc le fil des événements. Le 1er février, le président Trump nouvellement élu augmente les droits de douane sur la Chine de 10 %. Le 4 février, la Chine riposte en imposant des droits de douane de 15 % sur le charbon et de 10 % sur le pétrole brut. Le 3 mars, Trump augmente les taxes sur les produits chinois à 20 %. Le 4 mars, la Chine riposte en imposant des droits de douane de 15 % sur le poulet, le blé, le maïs et le coton ; de 10 % sur le soja, le porc, le bœuf, les produits laitiers, etc. Le 2 avril, les Etats-Unis passent à 54 % sur toutes les importations chinoises. Le 4 avril, la Chine annonce 34 % supplémentaires sur tous les produits américains. Le 7 avril, Trump menace les droits de douane sur la Chine à 104 %. Le 9 avril, la Chine riposte avec 84 % de taxes et Trump y répond le même jour avec des droits de douane à 125 % sur les produits chinois, puis à 145 % le lendemain. Le 11 avril, à nouveau, en représailles, la Chine annonce une augmentation à 125 %. On est là à un premier pic de tensions commerciales.
Ce bref rappel chronologique devrait nous aider à ne pas tomber dans le piège des caricatures chinoises nous montrant un Xi Jinping restant de marbre face à un Trump hystérique. En réalité, la Chine a répondu du tac-au-tac à chaque pression tarifaire venue de Washington.
Depuis, les événements ont pris une autre tournure, dont l’issue n’est pas encore claire. Le 11 avril, les États-Unis annoncent que des droits de douane réciproques excluront les produits électroniques grand public tout en maintenant 20 % pour ceux issus de Chine. Sortant de la politique tarifaire, la Chine riposte en suspendant les exportations de minéraux et d’aimants ; le 15 avril, la Chine ordonne à ses compagnies aériennes de ne plus accepter de livraisons d’avions Boeing. Le 17 avril, les États-Unis indiquent des droits de douane à 245% sur certains produits chinois.
Revirement de situation le 22 avril, lorsque Trump annonce qu’un deal est « proche » et qu’il envisagerait de réduire les droits de douane sur les produits chinois importés de 145 % à 50 % ou 65 %. En réponse, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (MAE), affirme : « Ce sont des fakes news. À ma connaissance, la Chine et les États-Unis n’ont engagé aucune consultation ni négociation sur la question des droits de douane, et encore moins conclu d’accord. » Le 23 avril, le hashtag « Trump s’est dégonflé » (特朗普认怂了) devient l’un des plus populaires sur Weibo, accumulant 170 millions de vues. Le 25 avril, le MAE exhortait Washington à cesser de « tromper le public » sur les négociations.
Pourtant, ce même jour, circulait sur les réseaux sociaux chinois, une liste de 131 catégories de produits dont l’exemption tarifaire serait envisagée (allant des vaccins et des produits chimiques aux moteurs d’avion, ainsi que huit types de puces).
Plus encore, un journal sud-coréen, 중앙일보 The JoongAng, publiait le 24 avril, un article intitulé : « après avoir nié tout contact… un haut fonctionnaire chinois visite en personne le département du Trésor américain », montrant pour preuve la photo prise d’un haut fonctionnaire du ministère chinois des Finances entrant au siège du département du Trésor américain à Washington, D.C., accompagné d’une dizaine de personnes, pour assister à la réunion des ministres des Finances du G20 qui se tenait du 23 au 24 avril à Washington. Selon toute vraisemblance, le sommet G20 a été l’occasion de discussions entre la Chine et les Etats-Unis. Néanmoins, il est essentiel pour la Chine d’apparaître forte et de nier jusqu’au bout toute négociation.
La ligne officielle est celle diffusée par He Yadong, le porte-parole du ministère chinois du Commerce : « Les hausses tarifaires unilatérales ont été initiées par les États-Unis. Si les États-Unis souhaitent réellement résoudre le problème, ils doivent supprimer complètement toutes les mesures tarifaires unilatérales contre la Chine. » Le principe même d’accepter des négociations sur la base des pressions douanières américaines signifierait pour Pékin avoir cédé au chantage. Or, la Chine doit montrer à ses citoyens, qui veulent y croire, qu’elle est au centre du monde, qu’elle a seule les cartes en mains, que l’Occident est négligeable et qu’elle est assez résiliente pour faire face.
Le fait que des négociations soient déjà en cours pourrait infirmer ce narratif. La Chine attendra que les Etats-Unis reviennent publiquement sur leurs tarifs pour annoncer un accord : chaque partie devant alors convaincre son public que c’est le meilleur accord possible pour le pays et que cela montre la valeur extraordinaire de leur providentiel leader. Ce qui atteste autant de la dépendance de la Chine à Washington que de la « Xijinpingsation » du président américain. De ce point de vue, quoiqu’il en soit, les Etats-Unis ont déjà perdu, non vis-à-vis de la Chine, mais du reste du monde : avec sa guerre commerciale tous azimuts, Trump a durablement affaibli la marque US.

2 heures et 42 minutes. C’est le temps réalisé le 19 avril par le vainqueur du semi-marathon de Yizhuang, à Pékin (北京半马), dans la catégorie « robot humanoïde » (人形机器人, rénxíng jīqìrén). Sur la ligne de départ, parallèle à celle des 12 000 coureurs humains, 21 machines, accompagnées de leurs guides (en chair et en os), chargés d’ajuster leur trajectoire ou de changer leurs batteries. Si certains robots ont gelé dès les premiers mètres, d’autres ont dû abandonner en chemin, après des chutes plutôt cocasses ou des cas de surchauffe. Seuls 6 ont réussi à finir la course et surmonter un terrain inégal, des graviers, des dos d’ânes, des virages serrés et des pentes raides…
L’intérêt de ce premier semi-marathon humanoïde ? Au-delà du coup de publicité certain pour les entreprises participantes, il s’agissait de tester en conditions réelles la fiabilité de leur robot et la robustesse des algorithmes en fonctionnement à haute intensité sur une longue durée.
Le champion, Tiangong UItra, a été développé par le Beijing Humanoid Robot Innovation Center, une coentreprise formée en 2023 par la municipalité et un certain nombre de compagnies de la tech, dont Xiaomi Robotics, filiale du groupe mieux connu pour ses smartphones et ses voitures électriques, et UBTech Robotics, une licorne de Shenzhen. Il faut dire que le robot d’1,8m et de 53 kg partait favori, étant spécifiquement conçu pour la course avec une vitesse de pointe de 12km/h (un rythme de jogging pour les humains). De plus, il jouait en quelque sorte « à domicile », puisque la JV a son siège à Yizhuang, important pôle industriel de la robotique à Pékin et dans le nord-est de la Chine.
Son challenger, le modèle G1 développé par Unitree, une start-up de Hangzhou, soutenue par Meituan, a fait un flop : quelques secondes après avoir salué la foule de la main, il a trébuché et s’est effondré juste après la ligne de départ… Cette performance décevante a fait l’objet de nombreuses critiques de la part d’internautes ayant gardé en mémoire l’incroyable chorégraphie de ces robots lors du gala télévisé du Nouvel An chinois. Bon nombre d’entre eux semblaient réaliser qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de créer un humanoïde convaincant. Ce tollé a poussé Unitree à se justifier : « les performances du robot peuvent varier considérablement en fonction de la personne qui l’exploite ou le développe ». En effet, ce n’était pas les ingénieurs d’Unitree qui étaient derrière les manettes, mais l’un de leurs clients.
Avec le recul, le choix d’Unitree de ne pas participer directement à cette « compétition » peut se comprendre, le G1 n’ayant pas pour vocation de courir des dizaines de kilomètres en continu. De fait, les compétences techniques de chaque entreprise sont différentes et peu comparables, chacune ayant en tête des usages bien spécifiques pour ses humanoïdes. Par exemple : les robots de service devront être dotés d’une paire de mains habiles et des capteurs polyvalents ; les robots industriels devront se montrer agiles et précis ; les robots utilisés à des fins militaires devront être robustes et endurants…
Contrairement à Tesla qui présente Optimus principalement comme un projet d’avenir et reste en phase de démonstration, les sociétés chinoises visent directement l’application commerciale dans des secteurs tels que la logistique, les soins aux personnes âgées, la sécurité, l’hôtellerie ou les services, misant sur des prix compétitifs et une production de masse dès 2025. Vers 2027, les robots entreront progressivement dans les usines et remplaceront les travailleurs dans les emplois pénibles ou à haut risque. Et ce n’est qu’en 2035 environ qu’on devrait voir des humanoïdes entrer dans nos maisons.
Ce qui est certain, c’est que les progrès futurs en robotique semblent plus susceptibles de se produire en Chine que nulle part ailleurs. Une étude de Morgan Stanley prénommée « Humanoid 100: cartographie de la chaîne de valeur du robot humanoïde » publiée en février, montre que 32 sociétés chinoises figurent au classement des 100 meilleures entreprises dans ce domaine*, avec respectivement 2, 21 et 9 entreprises dans les secteurs « cerveau » (semi-conducteurs, logiciels…), « corps » (capteurs, caméras, radars, lidars, connecteurs, batteries, câbles…) et « intégration » (ceux qui développent ou ont le potentiel de développer des humanoïdes). Les constructeurs automobiles (BYD, GAC, Xpeng, Xiaomi) sont particulièrement bien représentés dans cette dernière catégorie, conscients de l’opportunité que représente ces robots pour réduire l’intensité du travail dans leurs usines.
Cette forte présence chinoise dans le top 100 s’explique par un puissant écosystème manufacturier, des progrès rapides en intelligence artificielle et des politiques publiques favorables. Profitant de ces avantages, les entreprises chinoises entendent non seulement dominer le marché intérieur, mais aussi exporter leurs robots à l’international. Les robots humanoïdes seront-ils les prochains véhicules électriques ? Optimus et consorts n’ont qu’à bien se tenir.
* Deux sociétés françaises figurent au classement (Valeo et Dassault Systèmes), deux suisses (ABB, STMicroelectronics), une belge (Melexis).

Casque rouge vissé sur la tête, scooter électrique chargé à bloc : c’est ainsi que le fondateur de la plateforme de e-commerce JD.com, Liu Qiangdong, a fait le buzz le 21 avril en effectuant quelques livraisons de repas pour son nouveau service, « JD Waimai » (京东外卖). Après sa tournée, le milliardaire dont la fortune est évaluée à 6,3 milliards de $, a partagé un hotpot avec une dizaine de livreurs qui ont pu parler de leurs préoccupations.
Lancé au mois de février dans plusieurs grandes villes, dont Pékin et Shanghai, JD Waimai vient marcher sur les plates-bandes du leader incontesté du marché, le géant Meituan, qui détient 65% des parts de marché devant Ele.me (Alibaba) et ses 33%.
Avec des promesses de marges limitées à 5% et l’engagement de ne pas imposer de commissions jusqu’à la fin de l’année aux restaurants qui s’inscriront avant le 1er mai (contre 6 et 8% pour Meituan et Ele.me ), JD semble déterminé à redistribuer les cartes d’un marché où les pertes sont courantes. Par exemple, Ele.me n’a jamais pu dégager de bénéfice jusqu’à présent.
Pour arriver à percer, JD offre la livraison gratuite aux clients et des coupons de réductions à gogo : une stratégie qui n’est pas sans rappeler les débuts de Luckin Coffee, cherchant à s’imposer face à des chaînes bien établies comme Starbucks ou Costa Coffee.
Aux livreurs, clé de voûte de l’industrie, JD promet de garantir un volume de commandes suffisant pour compenser toute perte de revenus et propose même de recruter leurs conjoints comme coursiers ou agents de nettoyage. A ce rythme, le groupe espère recruter 100 000 livreurs d’ici à 3 mois, à qui le groupe offrira de véritables contrats de travail, incluant une couverture sociale complète (retraite, santé, chômage, accidents du travail, maternité et fonds logement). De quoi cultiver l’image d’un employeur responsable et surtout de quoi espérer séduire suffisamment de livreurs pour soutenir l’explosion de son volume de commandes (10 millions par jour fin avril à travers 166 villes, contre plus de 60 millions pour Meituan).
Plus encore, dans une « lettre ouverte adressée à tous les livreurs » publiée sur son compte officiel WeChat le 21 avril, JD accuse « certains concurrents » de forcer les travailleurs à choisir une seule plateforme, sous peine de voir leur compte suspendu. Le groupe du milliardaire Liu Qiangdong accuse également « une certaine plateforme » de ne pas payer les assurances de ses travailleurs qui ont souvent le statut d’intérimaire. En réponse, Meituan a démenti toute pratique restrictive et a, à son tour, accusé JD d’imposer à ses propres livreurs des pénalités sévères pour des retards ou des prises de commandes extérieures. Cette passe d’armes a fait perdre aux deux groupes 13 milliards de $ en capitalisation boursière.
A y regarder de plus près, même si JD paraît être à l’origine de cette offensive, Meituan est celui qui a commencé la guerre en lançant en début d’année « Shangou », un service de « shopping express » proposant de livrer sous 30 minutes, 24h/24, nourriture, cosmétiques et produits électroniques. Or, ce segment très prometteur se trouve aussi être le pré-carré de JD.com.
Ce climat d’accusations réciproques ravive le souvenir de l’enquête antitrust de 2021, qui avait coûté à Meituan 3,44 milliards de yuans (527 millions de $) sous la forme d’une amende pour avoir forcé les restaurants à travailler exclusivement avec le kangourou jaune.
Si les livreurs peuvent, de prime abord, bénéficier de cette rivalité, elle n’incite pas les opérateurs à améliorer les algorithmes qui les dirigent ou à assouplir les délais de livraison. Or, ces problèmes constituent les principales récriminations des coursiers qui mettent tous les jours leur vie en danger pour livrer à temps des « bubble tea ». Signe que leurs voix commençent à porter : Meituan a promis de mettre un terme cette année aux pénalités en cas de retard.
Les autres perdants de cette lutte pour le marché de la livraison de repas sont les clients de ces plateformes. En effet, l’essor de cette industrie, couplé à d’autres facteurs, tel qu’un style de vie plus sédentaire, a favorisé la prise de poids des Chinois. C’est particulièrement vrai chez les jeunes actifs, pour qui commander plats et boissons peu diététiques, une à plusieurs fois par jour, sans lever le petit doigt, est devenu une habitude. D’ici à 2030, 65% des Chinois seront obèses ou en surpoids, contre un peu plus de la moitié aujourd’hui. Et si le véritable combat à mener était là ?

- 采购, cǎigòu (HSK 5) : achat, approvisionnement
- 警方, jǐngfāng (HSK 6) : police
- 探索, tànsuǒ (HSK 6) : explorer
- 进展, jìnzhǎn (HSK 3) : avancées
- 控制, kòngzhì (HSK 5): contrôle
- 预测, yùcè (HSK 4) : prédire, prévoir
- 情绪, qíngxù (HSK 6) : sentiment, état d’esprit
- 可疑, kěyí (HSK 7) : suspicieux
- 监控, jiānkòng (HSK 7) : surveillance
- 录像, lùxiàng : enregistrement vidéo
根据政府采购文件和学术论文,中国警方和其他国内安全机构正在积极探索将AI的最新进展应用于社会控制,其中包括用AI模型来预测不满情绪。例如,中国沿海省份浙江的公安部门正在试验用多模态AI大模型标记可疑行为,并分析实时监控录像中大规模人群聚集的风险。
Gēnjù zhèngfǔ cǎigòu wénjiàn hé xuéshù lùnwén, zhōngguó jǐngfāng hé qítā guónèi ānquán jīgòu zhèngzài jījítànsuǒ jiāng AI de zuìxīn jìnzhǎn yìngyòng yú shèhuì kòngzhì, qízhōng bāokuò yòng AI móxíng lái yùcè bùmǎn qíngxù. Lìrú, zhōngguó yánhǎi shěngfèn zhèjiāng de gōng’ān bùmén zhèngzài shìyàn yòng duō mó tài AI dà múxíng biāojì kěyí xíngwéi, bìng fēnxī shíshí jiānkòng lùxiàng zhōng dà guīmó rénqún jùjí de fēngxiǎn.
Selon des documents d’appels d’offres gouvernementaux et des publications académiques, la police chinoise et d’autres agences de sécurité intérieure explorent activement l’application des dernières avancées de l’IA au contrôle social, notamment l’utilisation de modèles d’IA pour prédire les sentiments de mécontentement. Par exemple, les services de police de la province côtière du Zhejiang testent l’utilisation de grands modèles d’IA multimodaux pour signaler des comportements suspects et analyser, dans les enregistrements de surveillance en temps réel, les risques liés aux rassemblements de foule à grande échelle.
*************
- 预算, yùsuàn (HSK 7) : budget
- 灵活, línghuó (HSK 6) : flexible
- 网络主播, wǎngluò zhǔbò : influenceur en ligne / streamer
- 自由职业者, zìyóu zhíyè zhě : freelance
- 缴纳, jiǎonà (HSK 7) : cotiser
- 养老保险, yǎnglǎo bǎoxiǎn : assurance vieillesse / retraite
- 养老金, yǎnglǎojīn : fonds de retraite
- 流失, liúshī (HSK 7) : perte, érosion
- 影响, yǐngxiǎng (HSK 2) : impact, influence
- 房地产, fángdìchǎn : immobilier
中国最新的预算报告显示,超过40%的灵活就业人员(包括外卖员、网络主播和自由职业者)选择不缴纳养老保险。如果养老金信心持续流失,其带来的经济与社会影响可能不亚于房地产危机或出口放缓。
Zhōngguó zuìxīn de yùsuàn bàogào xiǎnshì, chāoguò 40%de línghuó jiùyè rényuán (bāokuò wàimài yuán, wǎngluò zhǔbō hé zìyóu zhíyè zhě) xuǎn zhái bu jiǎonà yǎnglǎo bǎoxiǎn. Rúguǒ yǎnglǎo jīn xìnxīn chíxù liúshī, qídài lái de jīngjì yǔ shèhuì yǐngxiǎng kěnéng bù yǎ yú fángdìchǎn wéijī huò chūkǒu fàng huǎn.
Le dernier rapport budgétaire de la Chine montre que plus de 40 % des travailleurs flexibles (y compris les livreurs, les influenceurs en ligne et les freelances) choisissent de ne pas cotiser à l’assurance retraite. Si la confiance dans le système de retraite continue de s’éroder, les conséquences économiques et sociales pourraient être aussi graves que la crise immobilière ou le ralentissement des exportations.
*************
- 关税, guānshuì (HSK 7) : droits de douane
- 明显, míngxiǎn (HSK 3) : évident, clair
- 软化, ruǎnhuà (HSK 6) : adoucir, assouplir
- 提振, tízhèn : stimuler, dynamiser
- 市场, shìchǎng (HSK 3) : marché
- 引发, yǐnfā (HSK 7) : déclencher, provoquer
- 缓和, huǎnhé (HSK 7) : détente, apaiser (une tension)
- 憧憬, chōngjǐng : espoir, aspiration
- 坚定, jiāndìng (HSK 5): ferme, inébranlable
- 屈服, qūfú (HSK 7) : céder, capituler
最近几天,美国总统特朗普(Trump)在对华关税问题上态度明显软化,这提振了市场,并引发对这两个全球最大经济体关系缓和的憧憬。但对中国领导人而言,这只会更加坚定他们的决心,认为只要他们继续等待,特朗普最终就会屈服。
Zuìjìn jǐ tiān, měiguó zǒngtǒng tè lǎng pǔ (Trump) zài duì huá guānshuì wèntí shàng tàidù míngxiǎn ruǎnhuà, zhètí zhènle shìchǎng, bìng yǐnfā duì zhè liǎng gè quánqiú zuìdà jīngjì tǐ guānxì huǎnhé de chōngjǐng. Dàn duìzhōngguó lǐngdǎo rén ér yán, zhè zhǐ huì gèngjiā jiāndìng tāmen de juéxīn, rènwéi zhǐyào tāmen jìxù děngdài, tèlǎng pǔ zuìzhōng jiù huì qūfú.
Ces derniers jours, le président américain Trump a nettement assoupli sa position sur les droits de douane contre la Chine, ce qui a stimulé les marchés et ravivé l’espoir d’un apaisement des relations entre les deux plus grandes économies mondiales. Mais pour les dirigeants chinois, cela ne fait que renforcer leur conviction que s’ils continuent d’attendre, Trump finira par céder.

En ce printemps 1965, sortant du Bureau des mariages au bras de son époux, la jeune Jiao voyait l’avenir aussi prometteur que les jeunes pousses vertes qui ondoyaient dans les champs de son agriculteur de mari. Les horribles souvenirs des années de famine s’éloignaient et les vieilles du village le lui répétaient à l’envi : ses hanches pleines donneraient naissance à de beaux garçons pour assurer la lignée de sa belle-famille.
Au moment des foins, son ventre en obus annonçait déjà le futur héritier mais, à la surprise générale, une fille naquit. Qu’à cela ne tienne, le prochain serait un garçon affirma le mari qui décida de nommer sa fille aînée Zhaodi, qui veut dire « faire venir le frère ». La belle-mère de Jiao et ses amies prirent les choses en main. Elles réfléchirent à mille plans, cent méthodes (千方百计, qiān fāng bǎi jì) pour que Jiao enfante un fils, l’héritier tant attendu.
Au cours de sa seconde grossesse, Jiao suivit un régime alimentaire strict. Elle mangea plus d’aliments riches en potassium et sodium, évita au contraire ceux riches en calcium et magnésium supposément associés à la conception d’une fille. Jiao se priva de tofu et avala jusqu’à l’écœurement des soupes au radis blanc et ignames. Peine perdue, une deuxième fille pointa le bout de son nez, appelée Pandi c’est-à-dire « dans l’impatience d’un frère ». À peine remise de ses couches, familles et amis se répandirent en injonctions et recettes-miracles. La voici trop entourée d’énergie féminine, yin, Jiao devrait regarder des films, lire des livres mettant en scène des héros masculins pour s’entourer de yang, et augmenter ainsi la probabilité d’un bébé mâle. Est-ce pour cela que le bébé bougea tant pendant cette grossesse ? Était-ce un garçon ? Que nenni, une troisième fille, arrivée avec de l’avance, prénommée Wangdi, « dans l’espoir d’un frère », suivie moins de dix-huit mois plus tard par une quatrième, Xiangdi, « penser au frère », conçue à la hâte dans l’espoir de prendre de court les esprits farceurs qui s’acharnaient à leur envoyer des filles.
Les vieilles du village revinrent à la charge. On bourra Jiao de bananes, riches en potassium et dont la forme symbolisait le sexe tant désiré ; elle fut priée de porter des sous-vêtements rouges, ils accueillirent deux chiens à la ferme, censés augmenter les chances d’avoir un garçon mais catastrophe ! elle croisa plusieurs fois des chats noirs pendant la période de conception, mauvais présage… Une cinquième petite fille vit le jour à la consternation générale. « Il faut l’appeler d’un prénom de garçon, insistaient les vieilles. Le charme sera rompu et le prochain, le 6 porte-bonheur, sera un garçon ! » Jiao hésita puis refusa, ne permettant à son époux qu’un peu plus d’autorité dans le prénom, il trouva Laidi, ce qui veut dire « un frère est en route ».
La chance serait avec eux pour ce numéro 6. On plongea Jiao dans des bains d’herbes, on recommanda certaines positions pendant la conception, par exemple s’asseoir en tailleur pendant et s’allonger les pieds en l’air juste après. Bref, ajouté à cela un régime draconien et des images de dragon collées un peu partout dans la maison, chacun se congratulait déjà du petit Buddha en route. Mais non, le sixième fut une sixième, appelée Yingdi « accueillir un frère ». Peut-être avait-on irrité les dieux en tentant de leur forcer la main ? On resterait dorénavant dans une attitude plus humble. Séances d’acupunctures quotidiennes, pas de café, pas d’aliments cuisinés avec de la sauce soja, pas de crabes, Jiao vivait ces grossesses comme une longue suite d’interdits et de réprimandes. Chacun de ses gestes, chacune de ses bouchées était commenté, approuvé ou condamné. Elle se pliait encore de bonne grâce à tout cela mais quand une septième fille naquit, Niandi c’est-à-dire « en manque d’un frère », elle se révolta. Qu’on ne vienne plus l’importuner avec des recettes miracles, des aliments répugnants à avaler, des postures, des pensées à avoir, des animaux à éviter, des vêtements à porter, des amulettes à arborer, elle lâchait tout ! Jiao se remit à manger le tofu qu’elle adorait, des agrumes, des produits à base de soja. Personne ne pouvait plus lui faire la moindre remarque et quand le village espérait un miracle en huitième position (huit n’est-il pas le chiffre porte-bonheur par excellence ?). Jiao réfléchissait déjà à un prénom qui exprimerait enfin son ras-le-bol. Ce serait Choudi « dans la détestation du frère », qu’elle imposa pour sa huitième contre l’avis de tous. Son époux espérait encore, économisa pour lui offrir de la poudre de perle, réputée freiner les signes de vieillesse mais aussi augmenter la libido… Une dernière grossesse et le rêve s’évanouit avec l’arrivée d’une neuvième fille qu’on prénomma Mengdi « le rêve d’un frère ». L’aînée, à vingt ans, se mariait déjà et le père de sourire… Pas de fils mais bientôt un petit-fils ?
Par Marie-Astrid Prache
NDLR: Notre rubrique « Petit Peuple » dont fait partie cet article raconte l’histoire d’une ou d’un Chinois(e) au parcours de vie hors du commun, inspirée de faits rééls.
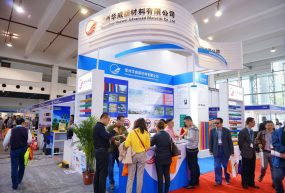
27 – 29 avril, Pékin : CIENPI, Salon chinois international de l’énergie nucléaire
28 – 30 avril, Shanghai : Intertraffic, Salon des technologies du trafic et de la mobilité
6 – 8 mai, Shanghai : E-Power/ G-Power, Salon international de la génération d’énergie et de l’ingénierie électrique
8 – 10 mai, Canton : CIHIE – International Integrated Housing Industry Expo, Salon international de l’industrie intégrée du logement et des produits et équipements d’industrialisation de la construction
8 – 10 mai, Shenzhen: Motor & Magnetic Expo, Salon international des petits moteurs, des machines électriques et des matériaux magnétiques
8 – 10 mai, Shenzhen: PMCC & AC Expo, Exposition internationale sur la métallurgie des poudres, le carbure cémenté et les céramiques avancées
8 – 10 mai, Canton : Steel Build, Salon international de la construction en acier et des matériaux de construction métalliques
8 – 10 mai, Canton : WBE – World Battery Industry Expo, Salon mondial de l’industrie des batteries
8 – 11 mai, Shanghai : Photofairs, Foire d’art contemporain à l’intersection de la photographie et des nouvelles technologies
9 – 11 mai, Shenzhen : Chinashop, Salon dédié aux technologies de pointe et aux nouvelles solutions pour le commerce de détail
10 – 12 mai, Canton : AAA Expo – Asia Parks And Attractions Expo, Salon des parcs et attractions
10 – 12 mai, Canton : China International Metal&Metallurgy Exhibition, Salon international de la métallurgie
12 – 14 mai, Shanghai : CIBE – China International Beauty Expo, Salon international de l’industrie de la beauté
13 – 15 mai, Shanghai : Intersec, Salon international de la sécurité et de la protection contre le feu
15 – 17 mai, Chongqing : CIBF – China International Battery Fair, Foire internationale de l’industrie des batteries
15 – 19 mai, Pékin : China Print, Salon international des technologies d’impression
15 – 17 mai, Canton : GITF – Guangzhou International Travel Fair, Foire internationale du tourisme en Chine
19 – 21 mai, Chengdu : CAHE – China Animal Husbandry Exhibition, Salon international pour les professionnels de l’élevage en Chine
19 – 21 mai, Shanghai : SIAL China, Salon international des aliments et boissons
19 – 22 mai, Shanghai : Bakery China, Salon international de la boulangerie et de la pâtisserie
19 – 23 mai, Pékin : WGC – World Gas Conference, Congrès mondial du gaz, de l’exploration à l’exploitation
20 – 22 mai, Canton : Interwine China, Salon chinois international du vin, de la bière, et des procédés, technologies et équipements pour les boissons
21 – 23 mai, Pékin : AIAE – Asian International Industrial Automation Exhibition, Salon international de l’automation industrielle
21 – 23 mai, Canton : API China / PharmChina, Salon de l’industrie pharmaceutique
21 – 23 mai, Canton : NFBE – Natural Food And Beverage Expo, Salon international des aliments naturels et des boissons santé
22 – 24 mai, Chengdu : CAPAS, Salon international pour les pièces automobiles et les services après-vente
22 – 24 mai , Xi’an : HosFair, Salon international des équipements et fournitures pour l’hôtellerie, de l’alimentation et des boissons
23 – 25 mai, Changchun : HEEC – Higher Education Expo China, Salon de l’enseignement supérieur
26 – 28 mai, Shanghai : R + T Asia, Salon professionnel des volets déroulants, portes et portails et protections contre le soleil
26 – 28 mai, Shanghai : Domotex Asia, Salon des revêtements de sol
27 – 29 mai, Shanghai : ITB China, Salon international du tourisme
27 – 30 mai, Canton : Prolight + Sound, Salon international des technologies du son et des éclairages
28 – 30 mai, Nanjing : CNF – China (Nanjing) International Emergency Industry Expo, Salon international de l’industrie des urgences
4 – 6 juin, Shanghai : BuildEx China, Salon chinois de l’industrie de l’approvisionnement en eau et du drainage
4 – 7 juin, Shanghai : Design Shanghai, Salon international du design
4 – 7 juin, Shanghai : DMC – Die & Mould China, Salon international des technologies pour les moulistes et les plasturgistes
5 – 7 juin, Canton : PaperExpo, Salon professionnel de l’industrie du papier
5 – 7 juin, Shanghai: CTEF, Salon international des équipements et procédés chimiques
9 – 12 juin, Canton : LED China, Salon mondial de l’industrie des LED
11 – 13 juin, Shanghai : AIE – Aircraft Interiors Exhibition, Salon international dédié aux intérieurs de cabines d’avions
11 – 13 juin, Shanghai : Biofach China, Salon et congrès des produits bio
11 – 13 juin, Shanghai : China Aid, Salon professionnel des soins aux personnes âgées, de la rééducation et des soins de santé
11 – 13 juin, Shanghai : SNEC – PV, Conférence et exposition internationales sur la production d’énergie photovoltaïque et l’énergie intelligente
12 – 14 juin, Canton : IHE – Inter Health Expo, Salon international de l’alimentation et des produits issus de l’agriculture biologique
13 – 15 juin, Canton : The Kids Expo, Salon et conférence sur l’éducation des enfants
18 – 20 juin, Shanghai : IOTE, Salon international de l’Internet des objets
18 – 20 juin, Shanghai : MWC, Salon et conférence du téléphone portable

