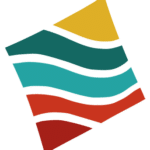Le 7 novembre, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rappelé devant le Parlement qu’un blocus chinois de Taïwan — ou toute action visant à empêcher l’arrivée des forces américaines — pourrait constituer une « menace existentielle » pour le Japon et justifier l’usage de la force en vertu de la loi de sécurité nationale de 2015.
Elle ne faisait qu’exprimer de façon directe une réalité stratégique : une crise dans le détroit de Taïwan toucherait immédiatement le Japon. Okinawa, où se trouve l’une des plus importantes bases américaines du pays, est plus proche de Taïwan que de l’archipel central. Imaginer qu’un conflit autour de l’île n’aurait aucune retombée sur le Japon relève de l’illusion.
Depuis lors, cette remarque a entraîné une série de réactions en chaîne de la part de Pékin, qui ne semblent pas prêtes à vouloir s’arrêter. Takaichi aura beau préciser le 10 novembre que ses propos étaient « hypothétiques », après avoir été menacée de décapitation par un diplomate chinois, rien n’y fait : la Chine a trouvé là un prétexte idéal pour menacer Tokyo et intimider quiconque voudrait soutenir l’île démocratique de 23 millions d’habitants.
S’ensuit alors une escalade quasi-quotidienne. Le 14 novembre, Pékin met en garde Tokyo d’une défaite militaire « écrasante » en cas d’intervention aux côtés de Taïwan. Le 15, trois compagnies aériennes chinoises assouplissent subitement leurs conditions de remboursement pour les vols vers le Japon. Le 16, les étudiants chinois au Japon sont exhortés à planifier leurs voyages avec prudence. Le 17, des distributeurs suspendent la diffusion d’au moins deux films japonais. Le 19, Pékin menace d’interdire les importations de produits de la mer japonais et gèle les discussions sur le bœuf. Le 20, la Chine reporte une réunion culturelle trilatérale avec Tokyo et Séoul.
L’escalade franchit un nouveau seuil le 21 novembre. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, l’ambassadeur chinois, Fu Cong, accuse Takaichi d’avoir commis une « grave violation du droit international » en évoquant la possibilité d’une riposte japonaise à une attaque contre Taïwan : « Si le Japon ose tenter une intervention armée dans la situation entre les deux rives du détroit, il s’agirait d’un acte d’agression : la Chine exercera résolument son droit de légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international et défendra fermement sa souveraineté et son intégrité territoriale. »
Pour expliquer cette « irritabilité » chinoise vis-à-vis du Japon, on invoque souvent les blessures historiques de la première moitié du XXᵉ siècle, notamment les atrocités commises en Mandchourie et le massacre de Nankin, où périrent environ 200 000 personnes selon le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient. Depuis les années 1990, Tokyo n’a pourtant cessé de présenter des excuses officielles pour ces crimes.
Reste une question : comment s’excuser si l’autre n’accepte pas le pardon ? En effet, Pékin continue d’entretenir ce sentiment anti-japonais, un ressort politique commode pour mobiliser l’opinion. Si les 200 000 morts de Nankin sont jugés impardonnables, pourquoi les 15 à 55 millions de morts du Grand Bond en avant ou les 2 millions de la Révolution culturelle ne le seraient-ils pas ? Le passé devient une arme politique : plus on ignore ses propres fautes, plus on charge celles de l’autre. Si l’Allemagne et la France avaient suivi la même logique, il n’y aurait jamais eu d’Europe.
Le fait de porter le différend au niveau de l’ONU paraît paradoxal. Accuser le Japon de violer le droit international pour une déclaration hypothétique sur la légitime défense surprend d’autant plus que Pékin n’a jamais dénoncé la Russie pour l’invasion de l’Ukraine, malgré les 100 000 à 400 000 morts — dont au moins 50 000 civils.
La stratégie chinoise, ici, diverge clairement de celle de Moscou. La Russie assume ouvertement sa logique de confrontation et justifie son agression ukrainienne par une lutte contre un Occident « décadent ». La Chine, elle, ne peut pas accepter d’être rangée dans le camp du « mal » : tout ce que fait la Chine est nécessairement juste. Pour cela, elle cherche à légaliser ce qui ne l’est pas : présenter toute défense de Taïwan comme une agression contre la Chine. Pourtant, Takaichi ne plaidait pas pour un soutien actif à Taipei ; elle constatait simplement qu’un blocus ou une invasion transformerait toute la région en zone militarisée, jusqu’aux eaux japonaises.
Au fond, Pékin cherche à obtenir du droit international une légitimation de l’annexion de Taïwan. Elle se base sur les déclarations de Potsdam et du Caire prévoyant la « restitution » de Taïwan par le Japon à la souveraineté chinoise. Or, d’une part, il s’agissait de déclarations d’intention et non d’accords juridiquement contraignants. D’autre part, la Chine signataire était la République de Chine et non la République populaire. Enfin, la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 octobre 1971, reconnaissant la République populaire de Chine comme « le seul représentant légitime de la Chine auprès des Nations Unies » concerne le continent et ne fait pas référence à l’archipel formosan. On peut certes en discuter. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’il y a une chose contraire au droit international : l’agression unilatérale d’un pays pacifique. Vouloir légaliser la criminalisation de ceux qui s’opposent à cette agression ne rend en rien celle-ci légitime.